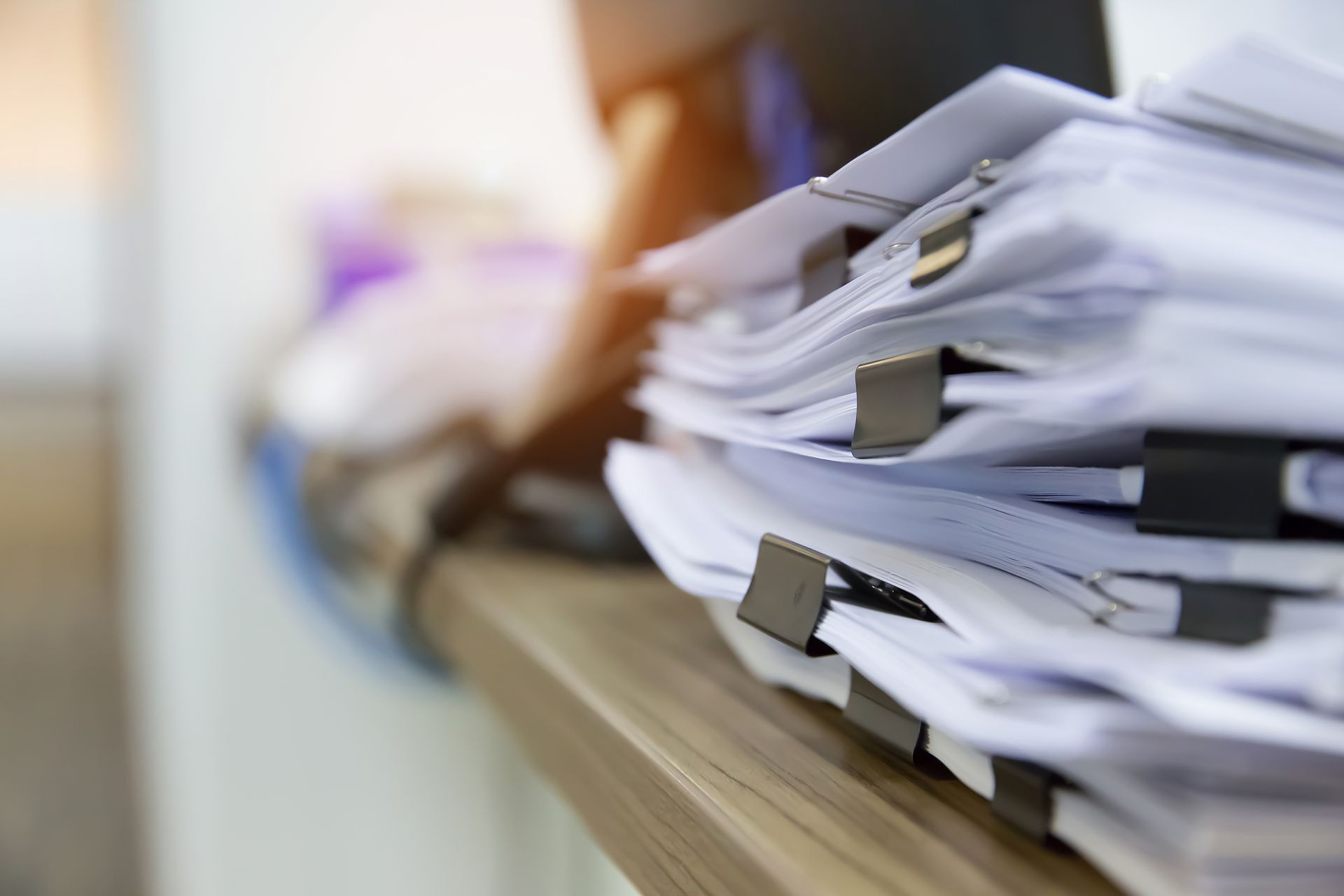Focus sur l’autoconstruction
En matière de vente, le vendeur est tenu des garanties des vices cachés susceptibles d’affecter le bien après la vente.
La garantie des vices cachés concerne les vices les plus graves qui rendent soit la chose impropre à sa destination soit qui en diminue tellement l’usage que l’acquéreur s’il en avait eu connaissance en aurait donné un moindre prix. L’acquéreur dispose alors d’une option entre la résolution de la vente ou obtenir une indemnisation couvrant la diminution de la valeur du bien.
En règle générale, les contrats intègrent une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, l’acquéreur prenant le bien dans son état sans recours contre le vendeur. Cette clause n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque le vendeur est un professionnel ou qu’il est fait démonstration qu’il avait avant la vente connaissance du vice affectant la chose. Dans ces deux cas le vendeur est en plus de la restitution ou de l’indemnité couvrant la diminution de réparer les préjudices qui découlent du vice (préjudice de jouissance).
A noter que la jurisprudence considère que le vendeur qui a lui-même réalisé des travaux à l’origine d’un vice caché est réputé avoir connaissance du vice de la chose.
L’action en garantie des vices cachés peut être engagée dans le double délai de 2 ans à compter de la découverte du vice par l’acquéreur et de 20 ans à compter de la vente.
Lorsque des travaux ont été effectués avant la vente, le vendeur engage également sa responsabilité au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. S’il a fait appel à des entreprises, ce sont ces entreprises et leurs assureurs qui devront indemniser l’acquéreur, le droit à agir étant transmis à l'acquéreur lors de la vente à moins qu’il en ait été stipulé autrement dans l’acte.
Lorsque le vendeur a lui-même réalisé un ouvrage (et non de simples travaux d’entretien ou de réparation) sa responsabilité peut être recherchée au titre de la garantie décennale.
La garantie décennale prévoit que le constructeur est responsable de plein droit des vices affectant l’ouvrage réalisé à moins qu’il ne prouve que ces désordres proviennent d’une cause qui lui est étrangère.
Aucune stipulation d’exonération de la responsabilité de la garantie décennale ne peut être intégrée dans un contrat.
En principe la garantie décennale ne vise que les désordres qui dans les 10 ans de la fin des travaux rendent impropres l’ouvrage à sa destination, portent atteinte à sa solidité ou à la sécurité des personnes. Toutefois la jurisprudence considère que le vendeur autoconstructeur est également tenu des vices intermédiaires c'est-à-dire des désordres découlent des travaux sans pouvoir atteindre la gravité suffisante pour déclencher la garantie décennale. Dans ce cas l’acquéreur doit démontrer une faute, un manquement à une obligation contractuelle ou aux règles de l’art. Une telle jurisprudence apparaît contestable car l’autoconstructeur réalise des travaux en qualité de non professionnelle et ne se soumet pas à des normes ni ne contracte avec lui-même.
La revente d’un bien qu’on a soi-même construit ou modifié peut être lourde de conséquences.
Certains assureurs commercialisent des contrats en matière d’auto-construction, ceci étant les exigences sont telles qu’il y a peu d’élus à la couverture du risque. Il faut donc être particulièrement prudent au moment de la vente et au besoin, outre les diagnostics obligatoires, faire visiter la maison par un expert en construction et joindre le rapport aux documents contractuels de vente.
En cas de réclamation de l’acquéreur, il conviendra d’être accompagné par un avocat pour étudier les suites à apporter.